
Des colons d’un nouveau genre
De Chute Libre à Desperate Housewives, le cinéma et la télévision US ont mis en scène avec un brin de délectation morbide les naufrages et burn outs des classes moyennes et supérieures blanches américaines. La série Ozark, produite par Netflix, nouvelle occurrence du genre, emmène un couple de bourgeois de Chicago dans une des régions les plus vides des Etats-Unis, les Mont Ozark, dispersés autour du lac artificiel du même nom. Un endroit étrange et propice à tous les fantasmes, situé dans le Missouri, loin des grands centres urbains, qui comporte assez d’étendues naturelles plus ou moins retouchées par la main de l’homme pour cacher des activités suspectes. C’est le point de départ de la série puisque Marty Byrde, un comptable propre sur lui, est sommé par le cartel mexicain qui l’emploie d’y aller se mettre au vert pour blanchir plus discrètement leur argent sale.

C’est donc dans ces espaces gigantesques, ceux-là mêmes qui accueillent le Spring Break des ploucs (moins coûteux que son équivalent floridien) que Marty travaille en cachette à enrichir ses patrons dealers. A partir de ce moment, le propos de la série se dédouble: on assiste au difficile maintien des apparences pour une famille blanche américaine typique qui s’effondre en secret et on retrouve le schéma classique des (anti)héros projetés dans un milieu à l’opposé du leur, et qui se débattent face à l’incompréhension de ceux qu’ils rencontrent. C’est probablement cet aspect qui rend la série plus intéressante, les cliffhangers à répétition n’apportant rien de neuf à ce que vous avez probablement déjà vu. La famille Byrde, par le prisme de leurs enfants, entre en contact avec des autochtones qui cochent toutes les cases de ce désormais marronnier du cinéma américain: la famille white trash. Caravanes en guise d’habitations, déscolarisation, alcoolisme, délinquance de bas étage voire soupçon d’inceste…autant de “travers” que vont activement travailler à rectifier la famille Byrde, sorte de colons d’un nouveau genre venus éduquer ces sauvages dont tous les curseurs sont poussés dans les excès.
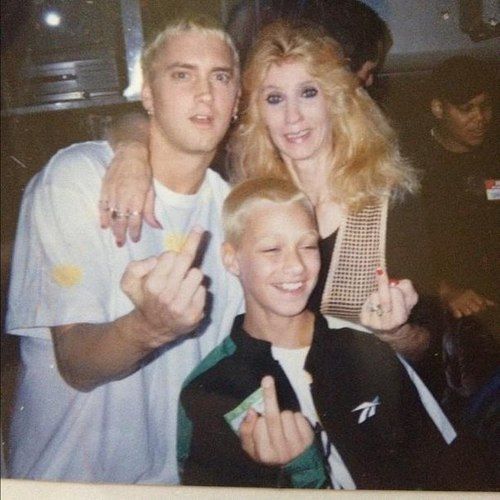
De Jesse Pinkman (Breaking Bad) à Eminem, de Lil Peep à Bhad Bhabie ou True Detective, la pop culture s’empare depuis des années de la pauvreté blanche pour l’esthétiser, la mettre en scène ou en faire un repoussoir. Pourquoi ce terme péjoratif reste-t-il si présent dans la musique et le cinéma actuels? Ne serait-il finalement pas, au travers de ses incarnations diverses, une forme de cheval de Troie de la suprématie blanche? Ou au contraire n’est-il pas une photographie des défaites et enjeux du capitalisme actuel? Voici quelques hypothèses qui tentent de répondre à ces questions.
Le tabou de la pauvreté blanche
Malgré ce que l’on pourrait imaginer, le terme white trash ne remonte pas au début de la diffusion télévisée de Dukes of Hazzard mais à un moment crucial dans l’histoire américaine: les années précédant la guerre de Sécession. En 1854, Harriet Beecher Stowe intitule ‘Poor White Trash’ un des chapitres de son livre La Case de l’Oncle Tom, Si, a posteriori, son roman a souvent été accusé d’être à l’origine de certains stéréotypes, au XIXème siècle, il a une résonance énorme, provoquant aux Etats Unis et dans le monde entier une prise de conscience de la réalité de l’esclavagisme. Son propos est d’autant plus intéressant qu’elle remet en cause plus généralement tout le système économique des plantations du Sud des Etats-Unis qui maintient en place l’esclavagisme et paupérise les classes blanches les plus populaires. La petite histoire raconte qu’Abraham Lincoln après sa rencontre avec Stowe aurait évoqué l’auteure en ces termes: « C’est donc cette petite dame qui est responsable de cette grande guerre ? »

A partir de ce moment, le terme white trash va être utilisé à la fois par les partisans de l’abolitionnisme, les Noirs qui désirent se différencier des Blancs les plus pauvres dont ils ne partagent ni les valeurs ni le mode de vie et ceux qui veulent maintenir l’esclavage et la ségrégation raciale. Au début du XXème siècle, on voit les adeptes du Darwinisme prendre pour exemple ces Blancs démunis comme un syndrome de la déliquescence de la société américaine en général, qui découlerait selon eux de la Guerre Civile et de ses conséquences. Au contraire dans les années 50, les militants pour le mouvement les droits civiques vont reprendre à leur compte le terme white trash pour accentuer le caractère rustre et non éduqué des Blancs du Sud des Etats-Unis qui luttent pour maintenir en place la ségrégation raciale. Ils les rabaissent pour décrédibiliser leurs propos abjects en quelque sorte.
Car, aux Etats-Unis, plus qu’ailleurs encore, la pauvreté est à la fois une anomalie et une forme de confirmation du système socio-économique en vigueur depuis la fondation d’un pays Gargantua qui, s’il mange de tout, digère difficilement les aspérités et particularités que son appétit implique. Le Blanc pauvre exprime une défaite du capitalisme dans ses déterminismes les plus eugénistes. Sa vision est insupportable pour les tenants du culte de la réussite. D’un autre côté, elle est pour certains penseurs noirs une forme de tremplin pour l’accession à l’égalité économique et sociale (puisque ce n’est pas la race qui déterminerait la capacité à se positionner dans le monde a contrario de ce qu’affirment les suprémacistes blancs). Les photographies bien connues de Dorothea Lange qui évoquent la Grande Dépression racontent exactement cela: elles sont un constat d’échec du système économique et social américain en pleine crise économique.
Mais alors comment passe-t-on de ce sentiment de pitié (partagé dans toutes les couches de la société sauf chez les principaux concernés) à celui de fascination ou de revendication d’une identité?

Retour à la terre et syndrome post-traumatique
Le fantasme des grands espaces à conquérir est intrinsèquement lié à la culture américaine. Il s’explique probablement par l’Histoire somme toute récente de ce pays et le déracinement de ceux qui l’ont fondé dans un climat de violence et d’individualisme sourd (le Sisters Brothers d’Audiard est un film récent qui retranscrit plutôt bien ce récit). Jusque dans les années 1960, l’industrialisation et le fait de vivre en ville correspond aux États-Unis à la réussite suprême. C’est l’Amérique de Norman Rockwell, ses pavillons de banlieue, ses enfants bien nourris et leurs vélos rouges briqués, ses diners où on déguste des produits laitiers entre gens du même rang. Or les mouvements de protestations, la guerre du Vietnam et les illusions hippies vont rebattre les cartes de ce bonheur utopique qui passe par le matérialisme. En parallèle du capitalisme rampant qui s’installe en ville, ses opposants vont commencer à rêver à une alternative, une échappatoire. Certains partiront en Europe mais la plupart n’iront pas chercher très loin. Hippies, punks, intellectuels et eco warriors en devenir quittent les villes dès la fin des années 1970 pour s’installer à la campagne. Ce mouvement ne s’est d’ailleurs pas tari. Il a simplement évolué. On peut prendre pour exemple la Farmer Veteran Coalition, un programme de réinsertion qui passe par le retour à la terre pour contrer une vague de suicide chez les soldats de retour d’Irak et d’Afghanistan. Ou le cas de n’importe quel groupe indie rock de Brooklyn poussé à la campagne par une vie en ville devenue trop coûteuse. Le message n’a pas changé: loin de la ville tout est possible. Mais cela n’a jamais fait de ces nouveaux arrivants des white trash pour autant. Comme l’exprime très bien cet extrait d’un entretien mené par Aaron Cometbus avec Bruce Anderson, journaliste vivant depuis les années 1970 dans une zone rurale californienne, dans son livre Le retour à la terre.
“Les rednecks voyaient dans le phénomène hippie-avec raison à mon sens-un énorme doigt d’honneur. Eux, ils payaient un crédit, allaient bosser etc..et ils se trouvaient face à ces gens qui n’avaient pas forcément la nécessité de le faire, et dont la vie était un pied de nez aux conventions traditionnelles.”
Ces quarante dernières années, le terme white trash et ces dérivés péjoratifs (rednecks ou hillbillies) sont devenus les composantes d’une identité revendiquée par les Blancs des classes populaires du Sud et Centre des Etats-Unis (ceux qui sont nés à la campagne dans des conditions difficiles) accentuant le potentiel fantasmatique d’une existence à l’apparence sulfureuse, dégagée des contraintes sociales et de la loi. Une vie ancrée dans une réalité jugée authentique et, il faut bien le dire, dans des contraintes dont manquent “tant” les plus privilégiés. “Dans le Sud, qui vous entendra crier?”. La figure du white trash incarne une sorte de réminiscence de l’esprit punk teinté de survivalisme, un mélange hypnotisant de Walden, Faulkner et Rob Zombie. De quoi exciter les artistes en quête d’inspiration et de reality check. Et plus généralement, les nantis en quête de limites et d’expériences extrêmes.

Un exemple récent et particulièrement parlant est probablement celui de Julia Fox (que vous avez sûrement vu en maîtresse de Adam Sandler dans Uncut Gems). Socialite new yorkaise nimbée d’une aura légèrement sulfureuse (elle a travaillé comme dominatrice SM), elle décide en 2016 de quitter son île pour partir en Louisiane. “J’avais besoin d’avoir peur. J’avais oublié ce sentiment. J’étais perdue depuis longtemps. Et j’avais besoin d’essayer quelque chose de nouveau.” raconte-t-elle au média Autre Love. Direction la Louisiane pour rejoindre son ami Jack Donoghue (un des membres du désormais duo parrain de la witch house Salem). Un séjour qui doit durer quinze jours mais qui se termine par une plongée infernale de 6 mois dans le Dirty South, Fox s’amourachant au passage d’un “prostitué sado maso” du nom de John Holland, l’autre moitié de Salem. Alors que le groupe est au pic, lui aussi, de sa descente aux enfers, Fox plonge tête baissée dans une vie de chambres de motels crades, de seringues, de pipes à crack, de passes et de Strip clubs plus glauques les uns que les autres. Après son départ, Salem s’installe dans une cabane en bois et compose une partie de Fires in Heaven (sorti en 2020). Julia Fox rentre, elle, à New York avec un paquet de photos et sort le bien nommé bouquin PTSD, (pour “syndrome post traumatique”), donnant au passage une vision assez juste de la fascination que cette pauvreté blanche exerce sur les élites intellectuelles new-yorkaises. Aux dernières nouvelles, Fox enchaîne les tournages et vient de donner naissance à un bébé, pendant que John et Jack se roulent des pelles entre deux shoots de meth, perdus quelque part au milieu des Etats-Unis.

Il est intéressant à cet endroit d’évoquer la destinée de Salem, drôle de projet (dont nous parlions dans le zine numéro 6) et qui fut reçu avec beaucoup de méfiance par la presse américaine à l’époque de son explosion à la fin des années 2000. Le trio est alors soupçonné de donner une relecture branchée de la culture white trash et surtout de cacher, derrière une attitude subversive, une appropriation culturelle de la culture noire du Sud. En 2010, Christopher Weingarten démolit le groupe dans le Village Voice dans ce qui reste probablement une des critiques les plus drôles des ces dernières années:
“Ils n’en ont rien, mais rien, mais rien, mais rien à foutre. De rien. Et pas d’une façon cool, nihiliste, à la manière dont Sid Vicious pouvait déconstruire les choses et cultiver l’auto-destruction. Plutôt du genre “je n’ai aucune passion, aucune fierté [bruit de pet]. Tu vas manger ces frites?” Et puis cette façon de mettre au premier plan une personne blanche qui se tient devant plein de gens pour freestyler de manière ridicule dans une sorte de Minstrel show (spectacle raciste où les Blancs se peignaient le visage en noir au 19ème siècle-ndr) version Southern Rap c’est nul!”
Le journaliste pointe justement du doigt l’omniprésence des voix pitchées vers les graves, typiques de la musique de Salem (et piquées chez Dj Screw) qui serait selon lui une façon pour ces petits Blancs de chanter “comme des Noirs”.
Après dix ans sans sortir de disques et une volonté affirmée de s’abîmer physiquement autant que psychologiquement (passant des soirées en compagnie de Terry Richardson, Marc Jacobs et Courtney Love à des jobs sur une plateforme pétrolière et, donc, la prostitution dans les bas fonds), les membres de Salem semblent avoir été plus atteints que l’on pensait par ces attaques sur leur authenticité sudiste. Pourtant nés dans le Missouri, les deux musiciens se sont quelque peu pris les pieds dans le tapis de leur identité et une subversion revendiquée. Ont-ils fini par croire les mensonges qu’ils racontaient? Ou sont-ils d’authentiques white trash jouant une musique un brin différente? Difficile de le savoir. Mais au fond ça n’a pas d’importance. Car l’identité white trash est revendiquée par de nombreux autres musiciens qui, s’ils se posent probablement moins de questions, nous laissent avec une autre interrogation: où se positionnent dans la société les Blancs pauvres en Amérique aujourd’hui?

White Trash Beautiful
En 2004, Everlast sort le titre White Trash Beautiful, un morceau rappé sur fond de guitares folk et de boom bap radiophonique. Le musicien y adresse une lettre d’amour à une figure féminine typique de la culture white trash: une serveuse qui vit dans une caravane une existence pénible. On assiste pourtant à une forme de déplacement: le terme n’est plus péjoratif, il devient une image réaliste du quotidien de beaucoup d’Américains blancs. Everlast, rappeur né à Los Angeles chantait la fierté d’être un fils d’immigrés Irlandais avec son groupe House of Pain sur le titre Top o’ the Morning to Ya en 1992: “Ya see I’m Irish, but I’m not a leprechaun, You want to fight, then step up and we’ll get it on, You’ll get a right to the grill, I’m white and I’m ill, A descendant of Dublin with Titanic skill. En 1998, il apparaît dans un décorum white trash typique sur la pochette de Whitey Ford Sings The Blues, album au succès gigantesque aux Etats-Unis, propulsé par le single What it’s like.
Everlast fait partie de ceux qui (avec plus ou moins de bonheur artistique mais un succès rarement démenti) œuvrent pour un crossover des musiques typiques du Sud, blanches (folk, hard rock, country) et noires (rap, trap, R’n’B). Kid Rock, Yelawolf ou Insane Clown Posse, tous ces artistes plutôt méconnus en France mais stars énormes aux Etats-Unis, véritables prescripteurs (voire gourous) pour les couches populaires blanches des zones rurales, offrent une nouvelle stature au terme white trash, revendiquant clairement cette identité de plouc comme un nouveau swag (et évidemment argument commercial). Des Blancs qui se mettent à jouer une musique née dans les communautés noires, ça ressemble à un déjà vu. Sauf que cette fois, il y a souvent un drapeau confédéré en arrière-plan.

Bombe à retardement
Le 6 janvier 2021, les partisans de Trump prennent d’assaut le Capitole à Washington DC. Têtes de loups, armes automatiques, t-shirts White Power, nuques longues, cannettes de Mountain Dew: tout l’attirail white trash est de sortie, capturé par les caméras du monde entier alors que les “trumpistes” venus de toutes les régions des Etats-Unis (de l’Arkansas à la Floride) sont venus rappeler que l’Amérique c’est eux ! Devant l’objectif du photo-journaliste Meld Cole, un partisan du président sortant, interrogé sur son potentiel racisme, s’exprime en ces termes: “je ne suis pas raciste, j’écoute du hip hop depuis toujours”. Une illustration de la bêtise crasse à laquelle on associe ces classes populaires depuis toujours? Ce n’est probablement pas à nous d’en juger. Avec un peu de recul, ce qui ressort de cet assaut et de la montée de ce suprémacisme blanc meurtrier aux Etats-Unis (légitimé largement par Trump), c’est que cette identité de déclassé, accompagné d’un terme péjoratif utilisé par les élites intellectuelles pour se différencier de la plèbe, se retourne aujourd’hui contre la société. Une forme de bombe à retardement qui finit par exploser en 2021 en pleine crise sanitaire et sociale aux Etats-Unis. Au point que Insane Clown Posse s’est décidé à commercialiser des t-shirts anti-drapeau confédéré pour faire le tri dans ses Juggalos (fans du groupe issus en grande majorité des zones les plus white trash de l’Amérique) entre suprémacistes blancs et antiracistes.

Faisons un retour en arrière. Le coup des rappeurs blancs, on nous l’a déjà fait avec les Beastie Boys, vendus par Rick Rubin et Russell Simmons comme un party band à la Beavis & Butthead avant le virage arty bouddhiste que l’on connaît. Dans le cas du trio, on avait affaire à des gamins de la haute de Manhattan propulsés sur un label historique du rap. Les paroles parlaient de jolies filles, de bières et de fêtes sans fin. Pas facile de s’y identifier quand on grandit dans une caravane dans un trailer park du Sud des Etats-Unis. C’est donc logiquement que les gamins Blancs des classes populaires se sont tournés vers ceux qui leur ressemblaient: Pantera, Slayer et bien sûr Eminem. Avec son alter ego, Slim Shady, le rappeur blond raconte son enfance fracassée, ses envies de meurtre, sa violence et ses addictions. Un discours qui frappe en plein cœur les gamins américains de l’époque. Un titre comme If I Had sur The Slim Shady LP (1999) est un plaidoyer pour les déclassés qui rêvent d’une vie meilleure. Il rejoint le lexique classique du hip hop (la réussite à tout prix), propulsé par un producteur noir iconique, Dr Dre. A une différence près: il ressemble à ceux à qui il s’adresse. Le white trash se scinde alors en deux: le homeboy blanc (penser dans la caricature à Riff Raff ou James Franco dans Spring Breakers) et le suprémaciste qui s’accroche à ce qu’il imagine être les contours de son identité comme au radeau de la Méduse. Car c’est finalement tout ce qu’on lui a laissé dans l’Amérique d’aujourd’hui (ce qui ne justifie en rien, vous l’aurez compris, le racisme et le terrorisme).

Il n’est pas très étonnant d’assister à cette forme de retournement et cette rébellion des classes populaires blanches. Laissés totalement pour compte par le capitalisme américain et ses multiples crises, ces déclassés qui habitent loin des grands centres urbains où semblent se concentrer les décisions autant politiques que artistiques n’ont plus que l’argument de leur supposée supériorité raciale pour garder la tête hors de l’eau. Une colère entretenue partout ailleurs dans le monde et qui explique la montée des extrémismes que cela soit en France, en Grèce ou au Brésil. La différence est peut-être à chercher dans le communautarisme typique des Etats-Unis qui amplifie encore les clivages et semblent peiner à couper définitivement les ponts avec son histoire et ses implications les plus effrayantes (génocides, esclavagisme). Reste qu’à force de fétichiser, moquer ou prendre pour défouloir voyeuriste (le succès de Tiger King en est un bon exemple) les couches les plus populaires, on finit par accentuer encore plus les oppositions de classes et de culture (sans parler des tensions raciales aux USA). Un climat généralisé de tensions entretenu dangereusement par une classe politique manipulatrice, qui finit par exploser et que même le plus malin des rappeurs ne pourra jamais apaiser.
ADRIEN DURAND
Ce texte est initialement paru dans le numéro 8 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.







