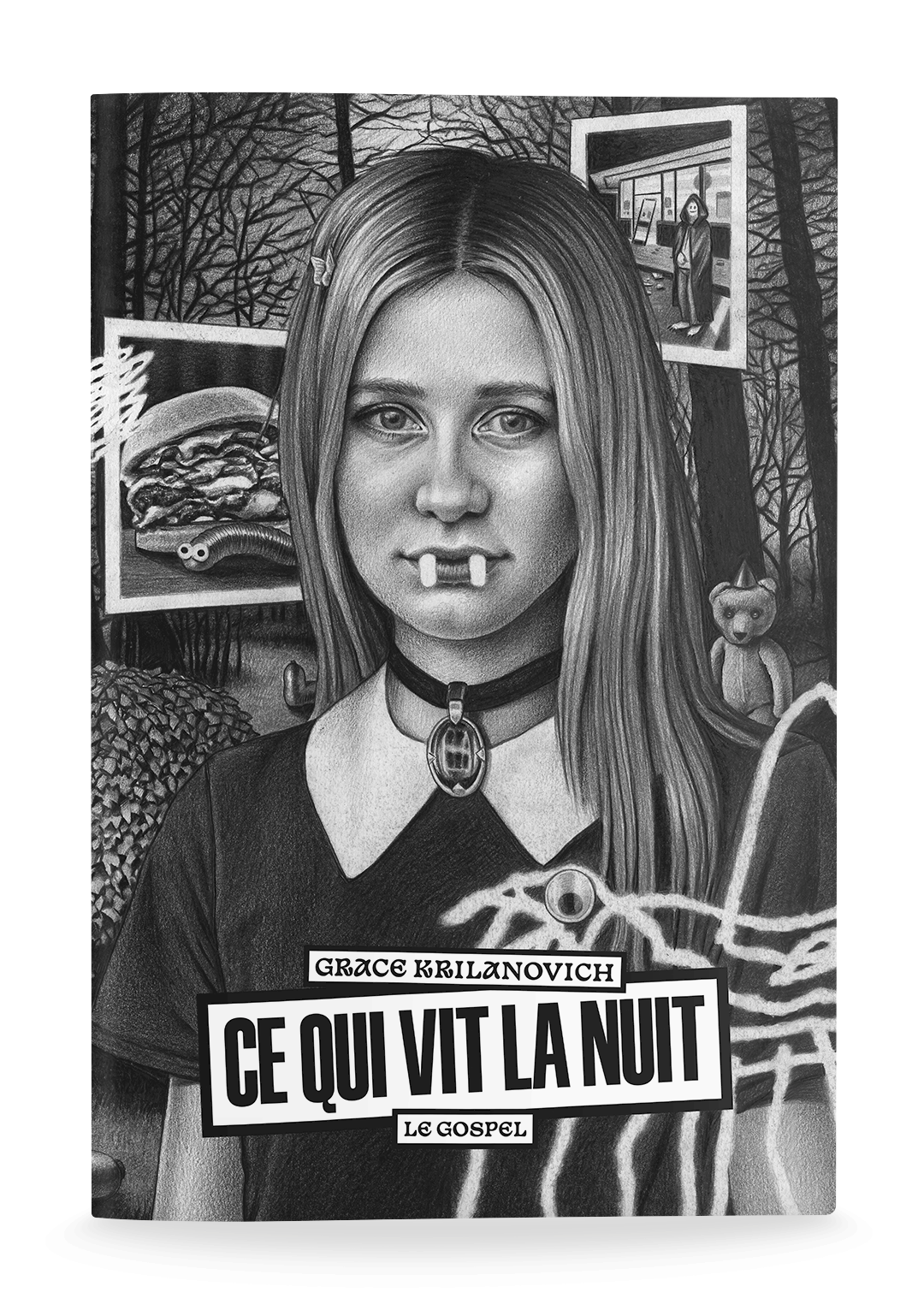“We were just a bunch of massive stoners trying to do something that no one else had done.”
Matt Pike
Ca pourrait ressembler à une blague (ou une après-midi de lycéens): trois amateurs de weed décident d’enregistrer un morceau à la gloire de leur précieuse herbe magique. Le résultat dure 1h03, tient sur une seule plage et va provoquer le split du groupe en même temps qu’une petite révolution dans les musiques extrêmes. Ce morceau, c’est le bien nommé Dopesmoker de Sleep, une formation qui a emmené la notion même de doom ou stoner rock dans une galaxie lointaine. Très lointaine.
75 000 dollars en fumée
Au début des années 90, Asbestosdeath est une première version de ce que va devenir Sleep. Formé dans la Bay Area autour de Al Cisneros (bassiste/chanteur), Justin Marler (guitariste, qui remplace un premier guitariste du nom de Tom Choi) et Chris Hakius (batteur), le groupe est rejoint ensuite par Matt Pike (deuxième guitariste). La formation se fait remarquer dans les sphères underground du metal et du hardcore avec une musique qui évoque une version salie au goudron californien de Black Sabbath ou Blue Cheer. Renommé Sleep (sur une idée de Marler qui finit par quitter le groupe pour devenir…moine!), et stabilisé en formule trio, la formation tape dans l’œil du label Earache qui sort Sleep’s Holy Mountain. Le disque crée un petit séisme chez les amateurs de brûlots lents et lourds. La musique du groupe se diffuse alors grâce au bouche à oreilles et à des tournées aux USA et en Europe aux côtés de Cathedral, Hawkwind et Cannibal Corpse. Sleep est même adoubé par un de ses maîtres à penser, Ozzy Osbourne saluant les jeunes pousses comme “le truc le plus proche actuellement du Black Sabbath des origines”.
Le groupe attire forcément les convoitises des majors qui à cette époque scrutent avec attention ce qui se passe dans les tréfonds de la civilisation fréquentés par des jeunes chevelus qui puent le mauvais shit et la bière tiède. Elektra pose une offre sur la table mais c’est finalement London Records qui remporte la mise avec deux arguments de poids: une liberté artistique totale et …75 000 dollars d’avance. Pendant ce temps, Sleep peaufine ce qui va devenir son nouvel album entre les soundchecks et les chambres pourries de motel d’autoroute. Un truc qui s’appellerait Dopesmoker et qui serait une ode à la weed. Un album composé d’un seul morceau.
“En 1995, on s’est retranché dans les bois et on a enregistré Dopesmoker ” racontait Pike en 2018 à Thrasher Magazine. “On s’est enfermé au Record Two Studio à Comptche en Californie et on a dépensé tout notre argent pour acheter de la weed, des amplis et des guitares. On a fait un break et ensuite on s’y est remis pour finir le disque. On a essayé de faire en sorte qu’il y ait un radio edit mais ça n’a pas marché. Voilà. C’était avant Internet et tout dépendait de la radio à cette époque. C’était un beau bordel”.
Parce que si London Records a signé une formation jusqu’au boutiste pour sortir un nouvel album, le label n’avait probablement pas envisagé ce cas de figure et tire une drôle de tronche à l’écoute de cette épopée doom de plus de soixante minutes. Le groupe retourne en studio avec Dave Sardy et tente de bosser une version plus courte de 52 minutes, intitulée plus sobrement Jerusalem (les stoners s’étant découvert une passion pour le Moyen Orient). Malgré cela, c’est une fin de non recevoir pour le label. Sleep split (pas facile à dire vite, attention) dans un contexte psychologique et relationnel extrêmement tendu. Mais la légende est en marche.
Tabula Rasa
Avant de parler du point de rupture occasionnée par cette oeuvre un peu folle, il serait intéressant d’évoquer un peu son contenu. Car au-delà du côté spectaculaire de son format, Dopesmoker est avant tout un grand disque de rock, au sens propre du terme, construit autour d’un mur sonique d’une nature avant-gardiste qui fait table rase des usages parfois assez dogmatiques du métal.
Minute Audiofanzine, voici comment le groupe a procédé pour enregistrer Dopesmoker. L’accordage de Pike descend dans les graves jusqu’au Do (pour vous donner une référence, le rock traditionnel se joue en Mi, le néo métal en Ré). Les parties de guitare et de basse sont enregistrées trois fois puis superposées (sur bandes analogiques, pas avec Pro-Tools, imaginez le délire) pour donner cette texture si grasse et lourde, qui deviendra caractéristique du groupe. Les amplis sont tellement nombreux et forts qu’on ne pouvait pas rester dans la pièce où Billy Anderson l’ingénieur du son avait posé 7 ou 8 micros (devant chacun des amplis). Décrit par Pike comme l’expérience d’enregistrement la plus exigeante de sa vie de guitariste, le résultat donne l’impression de tomber au ralenti dans un volcan en fusion.
Sleep n’est bien sûr pas le premier groupe à jouer sur les possibilités du volume, des motifs répétitifs et des fréquences basses (My Bloody Valentine, Steve Reich, LKJ, DJ Screw au hasard se sont frottés à des quêtes sonores empruntant les mêmes visées). Ce que va apporter Sleep c’est une véritable dimension de transcendance qui existe bien au-delà du simple headbanging. Un truc qui transperce le mur du son par ses vocalises quasi-chamaniques et des solos de guitare qui semblent avoir fait ressusciter Hendrix en lui plantant une aiguille de THC dans le cœur. Fumer Dopesmoker c’est trouver Dieu quelque part au milieu des cordes métalliques martelées par Pike, des éructations de Cisneros et des tambours de la mort de Hakius.
Une question d’espace
“Quand j’ai commencé à jouer de la musique, mes influences musicales étaient claires. Je veux dire: il y avait des groupes qui m’ont donné envie d’apprendre la basse, me consacrer à la pratique de l’instrument et commencer à écrire des morceaux. Mais plus on avance dans la vie, plus on fait ce boulot pendant longtemps, plus cette histoire d’influences devient un obstacle et n’a plus vraiment de sens. Tu veux avoir un espace vierge, tu es attentif à la quête de nouveauté, à la créativité, tu ne veux pas hériter de l’influence d’une autre musique. Ça n’a plus de sens” racontait Al Cisneros dans une interview à The Quietus en 2012.
Cet espace, il va le conquérir grâce à la fumette et il ne va pas y aller de mains mortes (c’est la première personne que j’ai vu utiliser une pomme pour se faire un bong dans les coulisses d’un concert de Om, un de ses autres groupes).
“J’étais accro à l’espace auquel je parvenais en fumant. Ce disque parle de ça” ajoute le bassiste. Dopesmoker est un des rares disques où la musique et la drogue entretiennent un vrai rapport de co-dépendance (sans mauvais jeu de mot) et font de cette longue plage peut-être l’une des œuvres psychédéliques les plus ultimes. Ici on sort de tout le decorum métal (il reste peut-être quelques “nerdismes” dans la pochette SF) pour parvenir à une autre réalité. Peut-on écouter ce disque sans être défoncé ? Absolument (“la drogue c’est mal m’voyez”) mais il paraît impossible d’imaginer un cerveau humain sobre (sans parler de ses bras) actionner un tel univers. Ce disque est un portail et renvoie tous les tâcherons mystico-métalleux à leurs parties de Dungeons & Dragons ou à leurs cosplay de lézards punks (le dernier arrivé est fan de Tool).

C’est sur les bancs de la fac où il est retourné après l’échec de Sleep que Cisneros a réalisé à quel point son groupe était devenu connu post-mortem. Car après son explosion en plein vol, le trio a été érigé en créature quasi-mythologique, fait l’objet d’un culte dont la Bible compte aujourd’hui quatre sorties et que Sleep rejoua dans des salles combles à la fin des années 2010. La seule chose qu’on peut finalement reprocher au groupe (façon de parler hein) c’est d’avoir donné du grain à moudre à ce qui est devenu le métal intello ou avant-gardiste. Dopesmoker existe au-delà de sa légende, de son gigantisme, de sa forme extraordinaire (au sens premier du terme). Il a réussi à mettre en musique la sensation physique de la défonce, à matérialiser sur des bandes analogiques l’état du corps sous l’effet des substances. Dopesmoker a matérialisé l’espace mystique de la drogue, il l’a rendu tangible. Un sacré exploit pour une bande de potheads quand on y pense.
ADRIEN DURAND