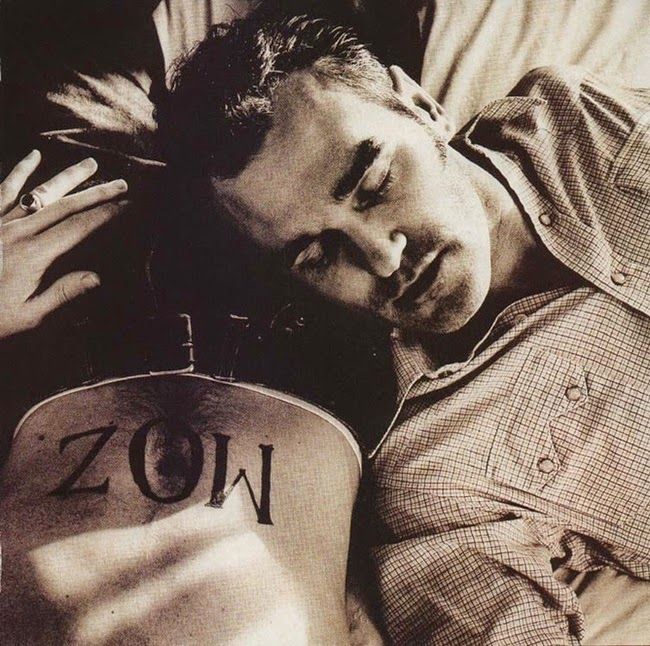Aujourd’hui tout le monde le sait : il ne s’est vraiment rien passé de bien fâcheux durant les quatre décennies qui ont suivies les années 50 : qu’est-ce qu’on a franchement retenu de la guerre du Viêt-Nam et du Napalm sinon les cheveux longs et The End des Doors ? Qu’est ce qui vient à l’esprit quand on invoque Margaret Thatcher sinon un perfecto couvert de badges, une épingle à nourrice et un morceau des Sex Pistols ? Qu’est-ce qu’on se figure quand on invoque la catastrophe de Tchernobyl sinon les rythmiques martiales et les pantalons en cuir propres au régime esthétique de la musique industrielle ? Des années 60, 70, 80, 90, la psyché collective ne retient toujours que les deux mêmes domaines : la musique et la mode (puis viennent ensuite le cinéma, les drogues et la littérature). Les mauvais souvenirs ont tous disparu. Le vêtement et la ritournelle édulcorent tout sur leur passage. Ce sont les agents de l’imputrescible « bon vieux temps » qui transfigure tout à son avantage. De la bouche de ceux qui l’ont vécu comme de ceux qui le fantasment, tout ce qui s’est passé avant sera toujours mieux que tout ce qu’il se passe maintenant. La musique était meilleure, les films disaient encore quelque chose, les drogues étaient abordables et moins coupées, le sexe libre et les fringues démentes, bref c’était le paradis total.

Image: Paul Mann
Des moments de ces décennies-là, le Swinging London est l’un de ceux qui remporte le plus de suffrage. Comment, en effet, ce sommet d’insouciance bigarrée à l’origine d’une chose aussi géniale que la Pop Music ne pourrait-il pas avoir fonction d’idéal depuis notre époque sombre et bancale ? Ellie, la désarmante héroïne de Last Night In Soho est de cette avis. Elle est toute à la mode et à la musique de cette époque. Elle rêve de la capitale britannique comme on rêve de machine à voyager dans le temps. Son attachement pour ce monde joyeux qui l’enchante autant qui l’inspire (elle est aspirante créatrice de mode) ne se limite pas à quelques questions de goût. C’est une dimension du temps et de l’espace sanctuarisé et à l’abri du monde qui lui permet de communiquer, dans les miroirs, avec le fantôme de sa mère (qui partageait sa passion). Admise dans une école de mode, Ellie va bien évidemment connaitre une cruelle désillusion. Grise, hantée par des filles arrogantes (du genre à s’appeler « Jocasta » sans nom de famille) et des silhouettes inquiétantes, Londres n’est plus Swinging pour un sou.
Proie d’un giallo aux prédateurs invisibles, ses écouteurs sur les oreilles Ellie se réfugie dans sa vieille pop, quitte le campus et s’installe dans une chambre de bonne louée par une certain Miss Collins (Diana Riggs) dans l’espoir de retrouver des traces l’époque qui l’enchante. La désillusion va pourtant se poursuivre sur un plan plus terrible encore. En revivant chaque nuit, sous forme de traversée des miroirs à peine rêvée, l’expérience de Sandie (la jeune femme qui occupait sa chambre dans les années 60), Ellie va progressivement se rendre compte que même pendant son âge d’or, Londres n’avait pas de quoi se glorifier de tout son Swinging.
L’affreuse aventure londonienne de Sandie, apprentie chanteuse qui convoite la gloire et finie livrée aux mains avides d’outrages d’ignobles gentlemen interchangeables à cigare et pince à chaussettes sur mollets poilus, est édifiante : le rêve du bon vieux temps est toujours un sale cauchemar – Swinging, peut-être, mais seulement with the Sharks. Car ces requins dissimulent le piège de leur quête de jouissance sur le chemin de la célébrité promise par leur pouvoir et leur réseau mais jamais atteinte par les intéressées réifiées et sacrifiées. Ces porcs, en les présentant le visage « baconisé », Edgar Wright les introduit dans le panthéon horrifique et nous laisse face au spectacle d’une exploitation systémique qui remonte aux origines de l’industrie du divertissement et du spectacle. On se retrouve comme Ellie, spectateurs effarés de l’effondrement de nos illusions passéistes.

C’est au titre de toute cette réflexion sur l’imaginaire qui hante les époques que la vocation des miroirs qui abondent dans le film est double. Ils ne reflètent pas uniquement le vernis des choses mais aussi les fantomatiques désirs qui accablent les fuites régressives et fantoches des passionnés du vintage. C’est cette connaissance profonde de la complexité duplice des choses de l’histoire (qu’illustrent à merveille les deux personnages qu’incarnent Diana Rigg et Terrence Stamp) acquise dans cette liberté laissée aux miroirs de « réfléchir » (dans les deux sens du terme) qui permettra à Ellie de véritablement s’épanouir artistiquement.
Mais par-delà cette démonstration, il se passe quelque chose dans Last Night In Soho qui hisse le film hors de ses propres enjeux scénaristiques ; quelque chose qu’emballe à elle-seule Anya Taylor-Joy. A chaque rôle toujours plus miraculeuse et étrangère aux lois de l’apesanteur, l’actrice ajoute du trouble à la réflexion à laquelle invite le film. Devant sa prestation inoubliable (et aussitôt iconique) d’égérie sixities, le spectateur, par un système de renversement particulier, se retrouve exposé aux mêmes problématiques qu’Ellie. La fascination qu’elle produit s’apprête elle-aussi d’élans mortifères. Il y a dans ce télescopage des épreuves et des révélations cette sensation que, de la même façon que le regard d’Ellie enferme Sandie dans un miroir, celui du spectateur enferme Anya Taylor-Joy derrière la surface d’un autre miroir. Celui qu’invoquent les films qui s’appliquent à nous faire ignorer toutes les mauvaises raisons pour lesquelles on n’aimerait pas vivre dedans, ceux dont l’image reflète mais ne réfléchit pas. En ajoutant de la réflexion (et une résolution) à la fascination, le film d’Edgar Wright échappe merveilleusement à cette catégorie.
ARTHUR-LOUIS CINGUALTE