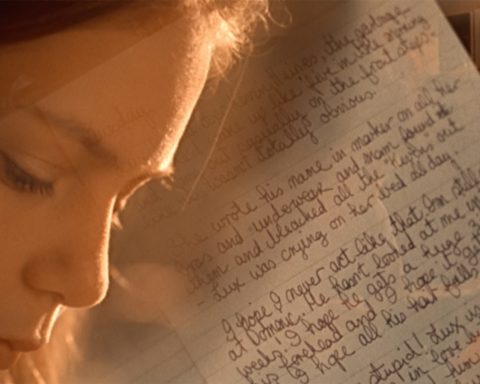Cet article est le quatrième de notre série « Insomnia » qui revisite de manière totalement subjective des films regardés de manière obsessionnelle, encore et encore, par nos contributeur.ice.s.
Garden State, premier film de Zach Braff réalisé en 2004, est une comédie dramatique relatant le retour au pays d’un jeune homme, joué par Braff lui-même. Parfait petit manuel du film indie hipster Sundance oriented du début des années 2000, je l’aime pour des raisons banales de film refuge, et s’il a traversé ma cinéphilie sans jamais peser dans ma liste de films favoris, j’y reviens autant pour ses qualités que pour ses défauts.
C’est le film qui raconte le sempiternel retour à la ville d’origine. Cette ville qui te connait par cœur et que tu arpentais, imperturbable dans tes fringues informes, écouteurs plantés dans les oreilles.
Un jour tu as choisi de la quitter, cette ville, pour tenter ta chance ailleurs (ailleurs étant bien souvent la grande ville) mais tu es comme tous les autres, et tu finis ensuqué par les transports en commun, par ton job de serveur, par les visages rêches et par tout le reste. Pour supporter ça certains fument, d’autres picolent, mais pour toi qui es médicamenté depuis l’enfance, le temps passe comme dans de la ouate, étouffé dans un ralenti, noyé dans une eau mercuriale. Alors, comme dans les manuels de scénario, l’appel de l’aventure te parvient par un coup de fil. Celui qui va tout bouleverser. Toi qui croyais que l’aventure avait pour principaux paramètres un ailleurs hostile, des épreuves et des rencontres hors du commun, et que ça t’apporterait une nouvelle connaissance du monde ; en lieu et place c’est ton père qui t’appelle : tu dois rentrer à la maison car ta mère vient de mourir. Tant pis pour les mages, les elfes et autres personnages mythiques, te voilà face à ce que tu fuyais : le dédain paternel et l’ennui chronique.

Quand ça va pas, on se réfugie dans des narrations rassurantes. De même qu’enfant on réclamait toujours les mêmes histoires (le fameux suspense paradoxal), on aime plutôt bien voir des films structurés toujours de la même manière. J’en ai quelques-uns sous le coude, et Garden State en est un bel exemple contradictoire, car il a justement l’aventure contre-intuitive : on y entre avec des certitudes (le personnage va répondre à l’appel de l’aventure évoqué plus haut), et on en sort avec la réappropriation d’un espace que le personnage avait, au contraire, volontairement fuit. Le système narratif qu’on connaît tous est revu et contredit.
Je ne me pose plus vraiment la question « pourquoi on re-regarde un film, pourquoi on ré-écoute un album… », je suis en passe d’accepter que c’est un réflexe tout autant cathartique que la création. Par contre, je suis toujours étonné qu’un film puisse créer en moi une impression de réassurance, grâce à des éléments vus et revus (spoiler alert : c’est un business et c’est donc calculé pour).
Quand ma cinéphilie s’est un peu emballée (early 90’s), les grandes révolutions narratives étaient déjà passées par là. Il me faudrait 10 ans de plus pour m’ouvrir à des “films d’auteurs radicaux“, me permettant d’apprécier d’autant plus certains films mainstream (l’un nourrissant l’autre), comme on apprécie le retour à la maison après bourlingue dans des contrées hostiles (j’en rajoute un peu, je sais). On en revient grandi, et on est plus alerte sur les petites choses qui font du quotidien, aussi sobre soit-il, une aventure des petites choses. Par exemple les films de Michael Bay et ceux de Weerasethakul : le premier est tellement dingue et indigeste que le second deviendrait une ennuyeuse promenade de santé. Chacun choisira son camp.
Garden State, lui, rebrousse chemin. Désamorçant l’aventure, il dédramatise. Ainsi il nous montre que les plus belles choses sont à notre portée. Rien de neuf ici, mais à l’époque ce fut un déclic.

C’est sûrement pareil pour la plupart des gens, mais il m’est impossible de rester focus seulement sur le personnage et la fiction, j’ai besoin de m’identifier à l’auteur-ice. Un des problèmes que je ressens face à ce film recoupe bon nombre d’autres films : un personnage avec des soucis similaires aux miens trouvera la clé pour s’en émanciper ; comme souvent, c’est l’œuvre d’un-e auteur-ice qui s’est servi du film pour raconter ses tourments et tracas puis tenter d’aller mieux. J’y vois comme une escroquerie : sa catharsis n’est pas la mienne (comme quoi, l’acceptation évoquée quelques lignes plus tôt, on n’y est pas encore), son film ne me soigne pas, cette personne se soigne sur mon dos, et parfois même ça lui rapporte de l’argent.
Et je comprends alors que si je ne crée pas ma propre légende, si je n’écris pas mes propres histoires, je serai à jamais malheureux.
C’est peut-être pour ça que j’y reviens comme un manuel, à ces films. Et donc à celui-ci en particulier. Car Largeman, le personnage principal de Garden State, c’est moi entre mes 20 et 30 ans, en train de ne rien faire de constructif sans que ça soit bien grave. Rien d’exceptionnel à dire qu’on apprend certaines choses de la vie en regardant un écran (faute d’encadrement, j’ai appris à me raser en regardant Loft Story). Ce que Largeman m’a appris, c’est à regarder par dessus mon épaule pour me rendre compte que tout ce que j’ai traversé est en fait plutôt ok, qu’il n’y a peut-être rien à souhaiter de plus.
Quant au personnage féminin, il a été l’occasion pour moi de découvrir une autre arnaque. En gros, on nous impose d’aimer une figure moult fois théorisée : la Manic pixie dream girl, jouée par Nathalie Portman . Ce personnage nous donne l’impression de combattre l’establishment par ses atouts d’antisociale (elle ment à tout va, élève des dizaines de hamsters, se comporte globalement de manière inhabituelle), sauf qu’elle est utilisée comme un faire-valoir. Cette typologie de personnage n’est généralement qu’un marche-pied vers quelques chose de plus fun dans la vie systématiquement morne du garçon. Ce quelque chose c’est donc cette fille. On a vu plus émancipatoire. Ici, elle sert le propos principal de notre héros : son désir de pleurer, sa recherche d’émotions (il est médicamenté par son père depuis tout petit, lui mettant toute sensibilité à plat). Cette touche de folie sera donc contrôlée : Largeman est tellement off, et elle tellement on, qu’à eux deux ça fera un truc dans la moyenne. A la fin de l’aventure, rien ne doit dépasser. Retour au socialement acceptable.

Certes, on est loin de la quête du héros habituel (pour une fois elle l’aide lui), et justement Portman l’aidera à se vider les poumons dans l’abysse infini, dans un cri mêlé à la chanson The only living boy in New York de Simon & Garfunkel. Là-dessus, ils s’embrassent pour la première fois, et moi je verse ma première larme.
Bien qu’elle soit presque devenue à elle seule un trope (sans oublier que la première occurrence de ce personnage remonte à Katharine Hepburn dans Bringing Up Baby de Howard Hawks en 1932), il est difficile de résister à cette énergie positive, hipster avant l’heure (française).
Pour en revenir au personnage joué par Braff, et puisque je me perds un peu en références, on sent évidemment qu’Hal Ashby, mais surtout Woody Allen, sont en train de faire la roue pas bien loin du plateau (Braff a d’ailleurs fait ses débuts cinématographiques dans Meurtres mystérieux à Manhattan du même Woody Allen en 1993. Tout se tient). Sans oublier l’utilisation de The only living boy in New York qui sonne comme un appel du pied à The Graduate de Mike Nichols (Simon & Garfunkel à la BO + spleen masculiniste = portrait d’une génération), horizon difficilement avouable tant il y a un gap dans la manière de raconter les histoires entre les deux auteurs : là où Nichols n’a besoin que de la mise en scène pour insuffler du drame dans la comédie (ou l’inverse), Braff fait de l’anxiété moderne (via des touches surréalistes bon enfant) un accessoire de mode forcé. Avec ça, il filme cette jeunesse comme il est désormais devenu indécent de la filmer : comme s’il n’y avait pas un problème de suffocation, comme si demain pouvait encore nous sourire. Et c’est d’ailleurs peut être pour ça que je pleure à chaque fois : serait-ce donc la fin de l’innocence blablabla..
Je ressens une étrange attraction / répulsion pour ce film. Autant refuge doudou qu’objet facile à critiquer, j’y vois une parabole de ma consommation musicale – et donc culturelle en général : convaincu que mon intérêt va principalement à l’expérimental, je passe pourtant mes journées à écouter FIP pop en me plaignant que tout ressemble aux Beatles.
Il est donc plus facile de regarder un film qui ressemble aux autres, car on sait d’avance comment réagir, et c’est rassurant de ne rien remettre en question. On s’assure d’en sortir comme on y est entré. Et pourtant, n’est ce pas là l’antithèse de ce que devrait être une œuvre d’art ?
DAMIEN STEIN