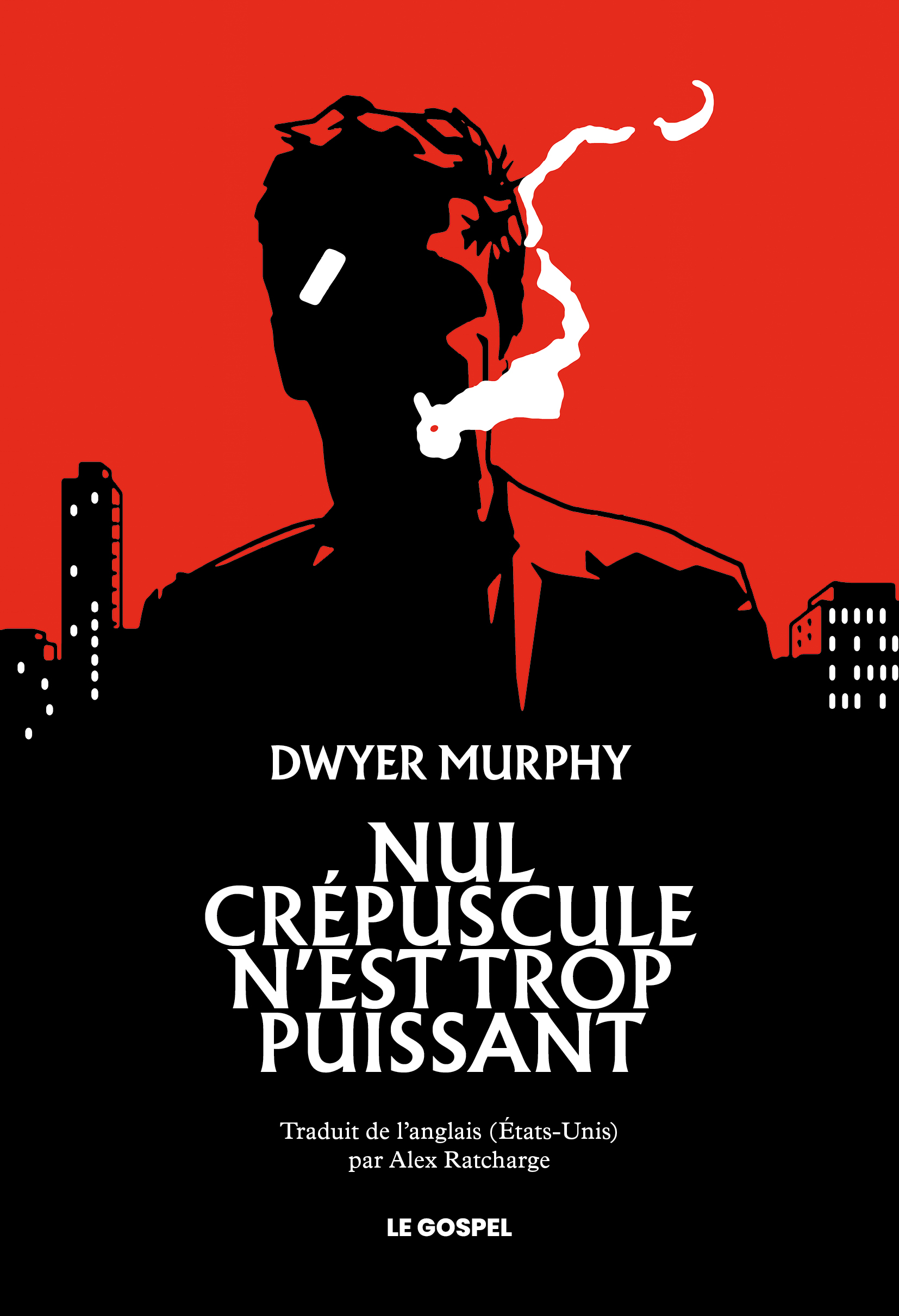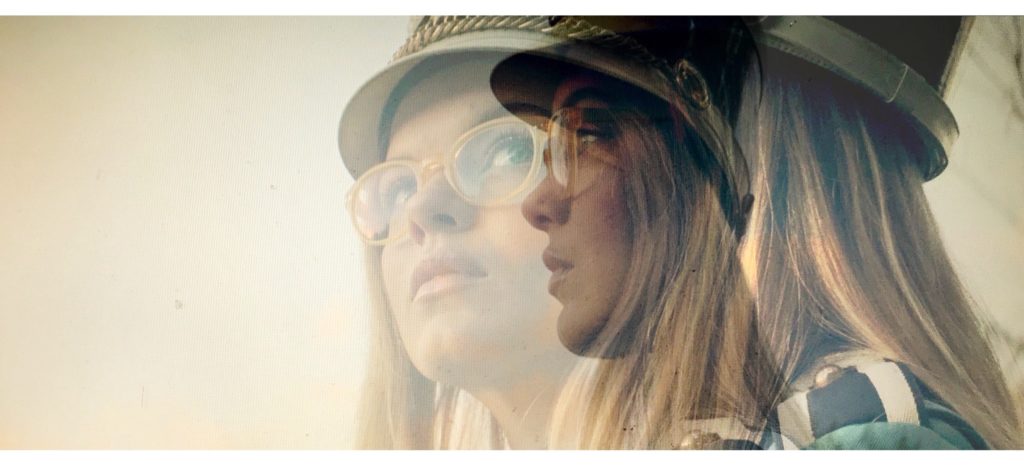
Sorti en 2019, ‘Knives And Skin’ de Jennifer Reeder se paie le luxe de réinventer le teen movie tout en donnant un éclairage nouveau à un sous-genre longtemps véhicule de clichés. En se penchant sur les défaillances des parents, la réalisatrice transfère le pouvoir à ses personnages féminins, dans un emballage narratif et visuel qui doit autant à Twin Peaks qu’aux nouvelles de Raymond Carver. Un Rrriot surreal thriller qui enterre le vieux monde avec une grâce folle.
Il y a quelque chose d’extrêmement familier dans le début du film Knives And Skin. Et il y a quelque chose de terrifiant qui se dégage de cette familiarité. Une adolescente en tenue de majorette sort du SUV d’un membre de l’équipe de football locale. Ils s’embrassent puis elle se refuse à lui. C’est le point de départ de sa disparition, soudaine, violente dont nous sommes témoins. La victime aura pris le soin de marquer avec son ongle le front de son assaillant en gravant son initiale dans sa peau. Une blessure qui ne guérira jamais et qui continuera de saigner tout au long du récit, comme une volonté d’inverser le schéma classique de la lettre écarlate et de donner un message clair: les bourreaux ne sortiront plus indemnes de leurs méfaits.
À partir de cette lointaine réminiscence du sort réservé à Laura Palmer dans Twin Peaks, Jennifer Reeder construit un décor sublime et inquiétant, à mi-chemin de la fable suburbaine gothique et du neo-noir féministe. Knives And Skin est imprégné d’une esthétique giallo, revisitée par des couleurs digitales et glacées (violet, rose, magenta, cyan). Un peu comme si un strip Club d’Atlanta avait dégueulé ses néons dans une banlieue du Midwest. À la suite de cette disparition, Reeder s’appuie sur ce paysage à la fois familier et irréel pour distordre le réel et faire apparaître les failles du monde des adultes. C’est donc avant tout par le personnage de la mère de la disparue, Lisa Harper (incroyable Marika Engelhardt), que l’on suit la décomposition d’une cellule familiale et de tout un idéal de réussite sociale avec elle. Déambulant dans la robe à paillettes de sa fille, couteau de boucher à la main, cette mère évoque un mélange de Carrie et Lux Lisbon. Elle est à la recherche d’une réponse, et l’on comprend rapidement que plus que la disparition de sa fille, c’est celle de sa jeunesse et du temps des possibles qu’elle interroge.

Que ce soit un père garagiste au chômage obsédé par l’idée de devenir clown, une mère occupée à des dessins d’enfants ou un prof persuadé qu’il a encore l’âge de ses élèves, tous les adultes de Knives And Skin racontent une société au bout du rouleau, complètement étrangère au réel qui ne peut plus compter que sur ses enfants pour fonctionner. Ceux-ci avancent à contre-courant, fiers de leurs différences et revendiquent l’existence de nouveaux schémas, amoureux, amicaux, artistiques. Ce n’est plus la revanche des nerds (comme le film du même nom de 1984), mais l’empowerment d’une bande d’amis décidés à s’extirper d’un monde fini qui veut les soumettre, malgré sa déchéance. Ce contre-modèle est incarné entre autres par une troupe de punks gothiques flamboyantes aux allures de Banshees post-apocalyptiques.
La réinterprétation des schémas préconçus s’incarne aussi dans un des coups de génies du film: une chorale de lycéenne qui réinterprètent a capella des standards catchy de la pop radiophonique des années 1980– Cyndi Lauper, The Go Go’s ou New Order (et secondent le magnifique score de Nick Zinner, des Yeah Yeah Yeahs). En place des hymnes à la fête et à l’insouciance, ce chœur donne à entendre des versions étirées, déchirantes qui transforment des tubes d’apparence inoffensive en véritables oracles. Girls Wanna Have Fun devient une complainte qui se mue peu à peu en l’exigence d’une liberté qui semble impossible (“personne ne part jamais d’ici” affirme froidement un des personnages masculins au début du film).

Knives And Skin dose avec brio les tributs à un certain cinéma de genre (Lynch, Argento, Donnie Darko) et développe sa personnalité propre dans son écriture scénaristique autant que dans son langage visuel. Sublimé par des tableaux photographiques somptueux (qui évitent l’écueil du film clippesque), le long-métrage permet à son discours politique de monter en douceur tout au long du récit, celui-ci prenant le spectateur un peu à revers de ses habitudes. Knives And Skin laisse totalement de côté l’enquête policière pour faire de ce féminicide de plus la faillite d’un système et de toute une culture cinématographique. C’est ce qu’exprime une des scènes les plus glaçantes du film lorsqu’un professeur remplaçant raconte à ses élèves qu’à l’époque de ses années lycée, une jeune camarade avait aussi disparue avant d’être retrouvée morte. “Elle s’appelait comment?” lui demande une de ses élèves. “Je ne m’en rappelle pas”, répond du tac au tac l’enseignant, confirmant que cette violence systémique ne pourra être résolue par les structures de l’autorité.
Étrillé par la presse française à sa sortie, Knives And Skin semble redécouvert dans les marges et vanté pour ses qualités créatives autant que militantes. On le diffusera lors de notre prochain ciné-club à l’Utopia de Bordeaux, le 9 avril, en espérant le faire (re)découvrir et rendre un peu hommage à cet outsider magnifique du cinéma américain récent.

ADRIEN DURAND
Cet article est paru initialement dans le numéro 11 du zine papier Le Gospel.