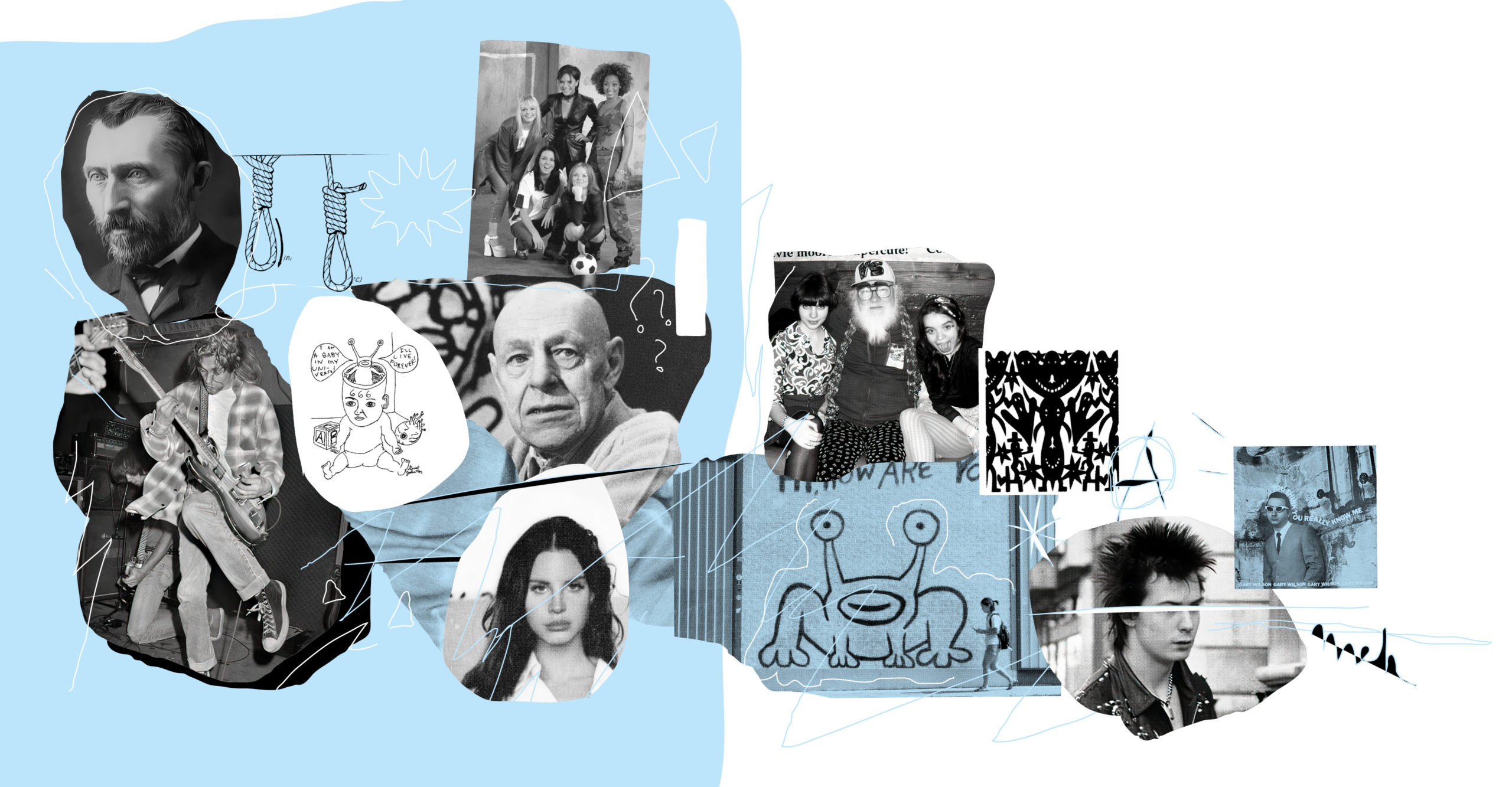Cet article est le huitième de notre série « Insomnia » qui revisite de manière totalement subjective des films regardés de manière obsessionnelle, encore et encore, par nos contributeur.ice.s.
Grands cadavres qui flottent en orbite autour de notre imaginaire ; théâtres désaffectés d’intenses émois esthétiques, ruines du patrimoine des souvenirs mémorables, antiques arènes aux émotions fortes qu’on visite à date régulière ; revoir les films qu’on aime c’est toujours faire une sorte de pèlerinage – offrir son respect, prier un peu, renouveler sa foi (essayer en tous cas), et, évidemment, garder en ligne de mire l’espoir de revivre à nouveau le miracle qui nous a fait y revenir.
Aguirre, La Colère de Dieu de Werner Herzog (1972) est un des lieux saints qui composent le territoire de ma cinéphilie (je n’aime pas ce mot) que je fréquente le plus. Système de cycles, c’est immanquable : il y a toujours un moment où il faut que je remette le casque de conquistador et que je retourne me perdre dans les méandres de l’Amazone à la recherche de l’Eldorado avec Werner Herzog et Klaus Kinski.
Je mets le casque parce que je ne sais jamais si, à la façon des personnages du film et de toute l’équipe, ce n’est pas la jungle (son mystère plus précisément) plutôt que le film – en tant que tel – que je fréquente le plus. Réflexion et démonstration simultanées, Aguirre, comme beaucoup de films de Werner Herzog, a cela de formidable qu’il est autant un film sur une expédition de conquistadors partis à la recherche de l’El Dorado, qu’un documentaire sur le tournage de celle-ci. Sommet d’irresponsabilité, rarement un film a paru si fou et inconfortable à faire, si impossible, si sidéré – autrement dit si en conformité avec l’expérience que vivent ses personnages. Tout transpire à la surface de l’image – au délire du héros (et de son acteur) répond celui du réalisateur. On s’abandonne comme les acteurs/conquistadors traitres au roi, menés par deux hommes fous, au grand vertige vert ; l’inconnu végétal comme espace éminemment, dangereux, vénéneux et fantasmatique. Et les mélodies jouées à la flûte de pan par un andain terrifié ne rendent que plus sinistrement dérisoire l’affaire.

On parle, depuis Baudelaire, de Calenture pour qualifier la fièvre qui fait voir aux marins restés en mer depuis trop longtemps de vastes prairies vertes à la place de l’océan. On sait maintenant ce que voient ceux qui sont perdus dans le grand vertige vert : une ville en or massif.
Même si, étant né à La Rochelle, l’océan gouverne la majeure partie de mon imaginaire, aussi loin que je remonte dans mes souvenirs traînent des images de jungle. De l’exotique, épaisse et impénétrable, méso-américaine, pleine de ruines précolombiennes et d’oiseaux aux couleurs improbables, empruntée aux photographies qui documentent les années passées par la famille de ma mère au Guatemala (à la fin des années 70). Je l’ai mise en scène mille fois cette jungle avec les aventures de mon grand-père, toutes ces histoires énigmatiques de carrière de Jade, de cimetières mayas, d’anciens nazis, de chamanisme syncrétique, de processions échevelées, de volcans que l’on sent respirer quand on se couche dessus, de débâcle à coup de machette, de personnages louches en costume cravate, d’irrésistibles mélodies de marimba, de crevettes remplies de cocaïne, de chat décapité et de traversée mortelle de la jungle à la lisière du fabuleux, et bien plus encore. Tout une dérive chimérique qui s’effiloche épouvantablement – et merveilleusement – à l’épreuve du lieu ; tout un film dans le genre : « … à la recherche El Dorado », ou « Déconfiture sur l’Amazone ».

Comme cette file démente de conquistadors accompagnés de leurs femmes, de soldats et d’esclaves, de lamas, de cochons, de chevaux et d’effigies de la vierge Marie qui, directement venus des nuages, descendent les pentes abruptes des derniers contreforts des Andes pour rejoindre la jungle (ou la plus belle introduction de l’histoire du cinéma), je regarde Aguirre comme je ferai un pèlerinage ; pour essayer de toucher quelque chose du délire, de ce que signifie l’inconnu, le lointain et l’inconfort extrême de l’hostilité générale ; de ce que signifie de s’être trouvé un El Dorado et de tout faire pour faire pour le manquer en beauté.
Lors de leur traversée, deux visions singulières se présentent à Aguirre et ses hommes film, pas des mirages (où alors la caméra a elle-même halluciné – ce qui est possible), mais des sortes d’aberrations cosmiques : le cheval, seul, avec sa capuche, qui, après avoir été jeté à l’eau, observe le radeau des conquistadors depuis la rive d’en face, et, surtout, le bateau à voiles suspendu au sommet de l’arbre.
Les films que je revois sont semblables à ce bateau à voile et les histoires guatémaltèques de ma famille à ce cheval. J’y reviens toujours, et je suis à chaque fois bien incapable de les résoudre.
ARTHUR-LOUIS CINGUALTE